Lettre T - Rouen FR
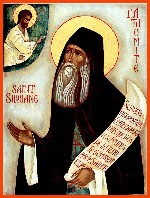

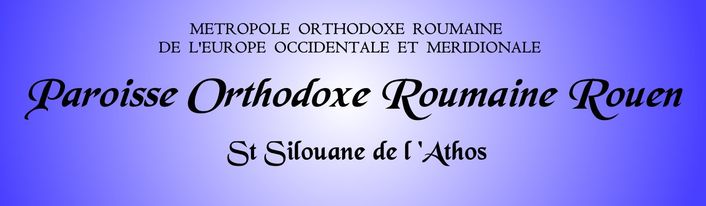
Lettre T
Lexique orthodoxe
Tchotki (n.m.) (slavon) : Voir chapelet.
Tempérance : Ascèse de l’amour, la maîtrise de tous les désirs.
Ténèbre (n.f.) : Au sing., réfère souvent à la nuée recouvrant les manifestations divines ; au pl., l’obscurité profonde de l’absence de Dieu dans l’enfer et la mort spirituelle.
Thaumaturge (adj. et n.) : Saint et sainte qui accomplit des miracles de son vivant ou après la mort.
Théologie : (du grec theos, " Dieu " et logos, " parole ") Connaissance de Dieu, plus spécifiquement, la connaissance mystique, immédiate et personnel de Dieu par l’expérience, au-delà de la connaissance intellectuelle. L’Église n’a accordé le titre de " théologien " qu’à trois personnes : saint Jean l’Évangéliste, saint Grégoire de Naziance et saint Syméon le Nouveau Théologien. Mais aussi, " celui qui prie vraiment est théologien " (Évagre le Pontique).
Théologoumenon (n.m.) : Doctrine ne relevant pas de la doctrine de foi proprement dite, opinion théologique.
Théophanie (n.f.) : (du grec, " manifestation de Dieu ") Aussi Épiphanie. Manifestation de Dieu à l’homme, à la fois dans l’Ancien Testament (exemples : Moïse et le buisson ardent et au Mont Sinaï) et dans le Nouveau Testament (le baptême et la Transfiguration du Christ). La fête de la Théophanie (le 6 janvier) célèbre le baptême du Christ.
Théophore (adj. et n.) : Qui porte ou manifeste Dieu.
Théosis : Voir Déification.
Théotokion (n.m.) : Tropaire ou stichère, souvent placé à la fin d’une série, en honneur de la Mère de Dieu ; parfois un développement dogmatique sur l’Incarnation.
Théotokos (n.f.) : (du grec, " celle qui enfante Dieu " ou " Mère de Dieu "). Titre principal de la Vierge Marie, attribué par le troisième Concile œcuménique réunie à Éphèse en 431. Tierce : La troisième heure, office célébré vers 9 heures.
Ton : Un des huit groupes de mélodies ou échelles modales sur lesquelles doivent être exécutées les pièces liturgiques.
Tradition : Transmission et actualisation de la vie en Christ, de la foi vivante depuis les temps apostoliques. Exprimée par les Saintes Écritures, le Credo, les définitions des Conciles œcuméniques, certains écrits patristiques, la liturgie, les icônes et les vies des saints.
Transcendance : Qualité de Dieu dont l’essence est au-dessus et au-delà de toute explication, concept, notion de temps et d’espace, hors d’atteinte de notre connaissance et compréhension. Voir aussi Apophatique et Cataphatique.
Triade (n.f.) : Avec une majuscule, la sainte Trinité.
Triadique : relatif ou dédié à la sainte Trinité, par exemple certains tropaires des matines.
Trikirion (n.m.) : Chandelier à trois cierges unies, dont se sert l’évêque pour bénir ; le trikirion pascal sert au prêtre durant les offices de Pâques.
Triode (n.m.) : (du grec, " canon à trois odes ") Ensemble de trois odes formant le canon de matines en Carême. D’où le nom donné à des livres liturgiques :Triode de Carême (contient les textes relatifs au Grand Carême ainsi qu’à la Semaine Sainte jusqu’au Samedi Saint) ; Triode de Pâques ou Pentecostaire (textes pour la période de Pâques jusqu’au dimanche qui suit la Pentecôte).
Triptyque : (du grec tripukhos " plié en trois ") Icône en trois panneaux, dont les deux extérieurs se replient sur celui du milieu ; l’image central est souvent le Christ Pantocrator, entouré de la Mère de Dieu et de saint Jean Baptiste, ou d’autres saints.
Trisagion ou Trisaghion (n.m.) : (du grec, " trois fois saint ") Hymne liturgique où le mot grec agios revient trois fois : Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous ; l’hymne est proprement considérée comme trinitaire.
Tropaire (n.m.) : Strophe ou courte hymne poétique résumant l’esprit d’une fête ; plus généralement, unité de base de la poésie et de la musique liturgiques byzantines.
Typicon (n.m.) : Livre contenant le cérémonial liturgique et les rubriques pour les différents offices, l’" ordo ".
Typiques (n.m.pl.) : Dans la Liturgie, désigne le groupe des Psaumes 102, 145 et les Béatitudes qui précède ordinairement la Petite Entrée. Office des Typiques : un office de communion pour les jour sans Liturgie, à l’instar des Présanctifiés en Carême.
Tyrophagie (n.f.) : (du grec tyros " fromage ") Dernière semaine avant le Grand Carême, pendant laquelle on peut manger les laitages et les œufs, après avoir éliminé la viande. Le dimanche de la Tyrophagie commémore le " Paradis perdu " par Adam.

