Lettre C - Rouen FR
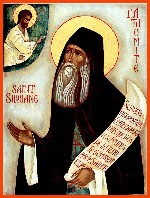

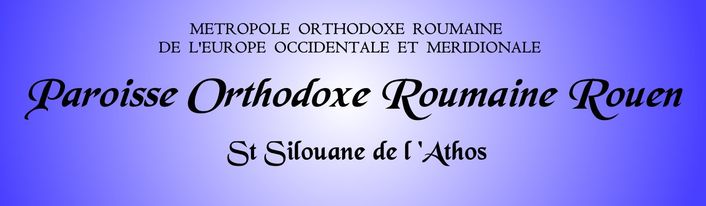
Lettre C
Lexique orthodoxe
Calendrier : Deux calendriers sont en usage dans les Églises orthodoxes, le calendrier julien (ancien calendrier) et le calendrier grégorien (nouveau calendrier). Le calendrier julien a actuellement treize jours de retard sur le calendrier grégorien. Ainsi, certains fêtes liturgiques ne sont pas célébrées aux mêmes dates dans toutes les Églises. Pâques par contre, ainsi que toutes les fêtes et les dimanches qui dépendent de Pâques, est célébrer le même jour dans pratiquement toute l’Église orthodoxe. Pâques est fêté le dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de printemps, calculé selon le calendrier julien, et après la Pâque juive. La date de Pâques peut ainsi tomber le même jour que dans l’Église romaine, ou avoir un décalage d’une à cinq semaines.
Calimavkhion ou Kalimafkion ou Kamilafkion (n.m.) : (du grec) Bonnet noir en forme de cylindre des moines et des moniales. Chez les Grecs, il est muni d’un petit rebord au-dessus du cylindre. Chez les hiéromoines des pays slaves, il est complété, dans l’église et à d’autres circonstances formelles, par un voile qui tombe dans le dos, formant ainsi le klobouk (russe). La skoufa ou le skoufos (du grec) est un bonnet noir en tissu mou à usage quotidien des moines.
Canon (n.m.) : (du grec " règle, loi ") Dans son sens liturgique, composition hymnographique typiquement divisée en neuf chants ou odes, lesquelles en leur tour se divisent en un certain nombres de strophes appelées tropaires. Peut aussi désigner une partie de la Liturgie, notamment, comme dans la Messe romaine, la prière eucharistique. En ecclésiologie, règle ou décision de l’Église, par exemple des conciles œcuméniques. Il existe aussi des canons concernant les icônes, leur vénération et leur peinture.
Carême (n.m.) : (du latin, quadragesima, " quarantième ") Période de jeûne ou d’abstinence (de viande et de laitages). Le Grand Carême précède la Semaine Sainte, du lundi après le dimanche du " Paradis perdu " (ou de la Tyrophagie) au vendredi avant les Rameaux ; le carême de Noël, du 15 novembre au 25 décembre ; le carême des Apôtres, du lundi après le dimanche de Tous les Saints (qui suit la Pentecôte) au 28 juin ; et le carême de la Mère de Dieu ou de la Dormition, du premier au 14 août.
Cataphatique (adj.) : (du grec cataphasis " affirmatif ") L’approche de Dieu qui procède par affirmation. Voir Apophatique.
Catavassia, Katavasia ou Catavasie (n.f.) : (du grec, " descente ") Strophe chantée à la fin de chaque ode des matines, qui peut être l’hirmos de l’ode, l’hirmos d’une grande fête ou une catavassia de la Mère de Dieu.
Catéchumène : (grec " enseigné, instruit à vive voix ") Candidat au baptême.
Cathisme (n.m.) : (du grec " assis ") Partie de l’office durant laquelle on peut s’asseoir. Pour leur usage liturgique, les 150 psaumes sont groupés en vingt sections appelées cathismes, eux-mêmes divisés en trois stichologies ou stances.
Catholicon (n.m.) : (du grec katholikos, " universel, selon le tout, dans sa totalité ") Église principale d’un grand monastère.
Catholicos (n.m.) : Primat d’une Église, en dehors des frontières orientales de l’Empire Byzantin ; le titre reste en usage chez les Arméniens et les Assyriens.
Catholique : ". Un des quatre attributs de l’Église dans le Credo ; la vérité chrétienne, révélée, donnée à l’Église et destinée à tous ; l’Église dans sa plénitude, dans toute la profondeur de la vérité. Lorsque ses membres sont orthodoxes, l'Église est dite "catholique" parce qu'elle s’identifie alors à la totalité du Corps du Christ. Depuis le schisme entre l’Orient et l’Occident et dans le langage populaire, le mot " catholique " sert souvent à désigner l'Église romaine et ses fidèles, tandis que le mot " orthodoxe " sert alors à désigner les Églises qui ont conservé la foi orthodoxe.
Cénobite (n.m.) , cénobitique (adj.) : (du grec koinobion " vie commune ") Désigne ou concerne le moine ou la moniale qui vit en communauté. VoirAnachorète.
Chalcédoine : Ville d’Asie mineure, sur le Bosphore, où s’est tenu en 451 le IVe Concile œcuménique par lequel a été défini l’union des deux natures, divine et humaine, dans la seule personne du Christ. Les Églises PréChalcédoniennes sont celles qui n’ont pas accepté les définitions de ce Concile ; il s’agit notamment des Églises d’Égypte (les Coptes), d’Arménie, d’Éthiopie et l’Église Jacobo-Syrienne.
Chapelet : Le chapelet ou rosaire chez les orthodoxes, souvent en laine, typiquement noire, formé de cent nœuds (aussi de 33 nœuds ou de 300 nœuds), est utilisé surtout pour la récitation de la prière de Jésus. Chez les Grecs, komvoskhinion ou komvologhion ; chez les Slaves, viervitsa ou tchotki.
Charisme (n.m.) : Grâce particulière ou don de l’Esprit-Saint au service de l’Église (cf. 1 Co 12, 1-27).
Chérubikon ou Chérubicon (n.m.) : " L’hymne des Chérubins " Hymne chantée pendant la Grande Entrée, par lequel les fidèles sont invités à chanter l’hymne trois saint et à déposer " tous les soucis de ce monde... pour recevoir le Roi de toutes choses ", rejoignant ainsi le chœur des anges dans les cieux pour le célébration commune du Mystère eucharistique.
Chrême (Saint) (aussi Myron) (n.m.) : (du grec chrîsma, " huile d’onction ") Huile consacrée par le Patriarche, servant dans le sacrement de chrismation et d’autres consécrations : églises, autels, antimensions, icônes... Chrismation (n.f.) : Un des sept principaux sacrements, conféré sous forme d’onction avec le saint chrême ; correspond à la confirmation dans l’Église romaine.
Cœur : Dans la spiritualité, " cœur " prend son sens sémitique et biblique : le centre de l’être de la personne, du corps, de l’âme et de l’esprit ; la totalité de la personne humaine.
Commun : Partie fixe ou invariable des offices, en lequel sont insérées les parties variables (ou propre) selon le jour, la fête etc.
Communion : Consommation des Saints Dons consacrés en Saint Corps et Précieux Sang du Christ pendant de la Liturgie, tel qu’institué et souhaité par le Seigneur lors de la Dernière Cène. Dans l’Église orthodoxe, la communion se fait toujours aux deux espèces, le Pain et le Vin. Le clergé communie séparément au Pain et au Vin, et la communion est donnée aux fidèles typiquement par le moyen d’une cuiller que le prêtre utilise pour prendre un morceau de Pain trempé dans le calice contenant le Vin.
Communion des Saints : L’Église au sens le plus large : l’union de l’Église terrestre – tous les fidèles vivants - et l’Église céleste - ceux qui sont déjà devant Dieu et qui intercèdent pour les vivants - indissolublement liées par l’Esprit-Saint dans une communion avec Dieu, qui s’exprime en particulier par la Divine Liturgie.
Complies (n.f.pl.) : Office par lequel on " achève " la journée, avant d’aller dormir.
Componction : État de l’âme où on se sent envahi par le repentir ; recueillement fait de tendresse et de douleur.
Confession : Action de " se confesser ", de reconnaître son état de pécheur et d’avouer ses fautes ; ainsi, le sacrement par lequel les péchés sont absolus. Aussi " confesser " le Seigneur qui est bon, reconnaître sa miséricorde infinie. Consécration : Terme employé pour la consécration d’une église. Aussi, les paroles de l’Institution de la Divine Liturgie. En ce qui concerne la sanctification des Saints Dons, voir Épiclèse.
Consentement : Dans les écrits ascétiques, prémices de l’état de péché, quand la pensée ou suggestion a vaincu la vigilance. Voir aussi métanoïa.
Consubstantiel (adj.) : (du latin consubstantia ; traduit le grec homoousios) De même substance. Se dit des trois personnes de la Sainte Trinité, l’une par rapport à l’autre.
Contemplation : (traduit le grec théoria) Sensation spirituelle de Dieu dans le cœur, au delà de la prière ; aboutissement et transfiguration de l’action, la praxis monastique.
Conversion : Action de se tourner vers Dieu, après s’être éloigné de lui. Traduit le grec métanoïa.
Cosmos (n.m.) : (grec, " ordre, univers ") L’univers comme création divine harmonieuse ; le péché y introduit le désordre, et il incombe à l’homme, par l’Incarnation du Christ, de ramener toute la création à la glorification de Dieu. Voir Ex nihilo.
Couleurs liturgiques : À chaque temps liturgique correspond une couleur qu’il est bon de suivre dans le cadre de la symbolique liturgique : or ou doré – temps liturgique quotidien ; bleu - fêtes de la Mère de Dieu ; blanc – temps pascal ; rouge – les martyrs et la Pentecôte ; couleurs sombres (violet ou noir) - temps du carême et défunts.
Coupoles : Dômes surmontant des églises orthodoxe. Une coupole sur le nef de l’église symbolise le ciel audessus de la terre ; cinq coupoles représentent le Christ et les quatre évangélistes.
Couronnement : Office du couronnement des époux, terme employé pour désigner le sacrement du mariage orthodoxe. Les couronnes signifient que chacun des époux est la couronne de l’autre, et aussi la couronnes des martyrs, thème important du rituel de mariage orthodoxe.
Credo : (latin " je crois ") Voir Symbole de foi.

