Lettre M - Rouen FR
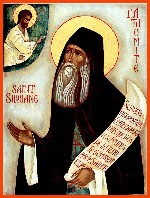

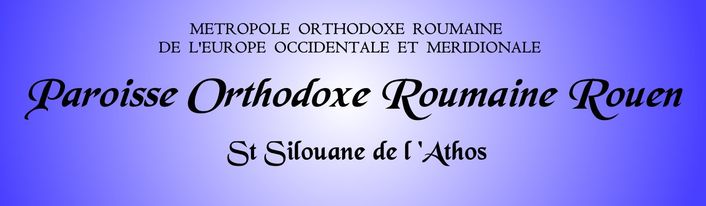
Lettre M
Lexique orthodoxe
Mandylion (n.m.) : (grec : " petit manteau, tissu ") Icône avec le visage du Christ.
Matines (n.f.pl.) : Office matinal, célébré avant le lever du soleil ; appelé aussi Orthros.
Méditation : Soin, attention et exercice de l’attention.
Mégalinaire (n.m.) : (du grec " magnifier ") Refrain chanté entre les tropaires de la neuvième ode des matines ; plus spécifiquement, hymne de la Divine Liturgie chantée en honneur de la Mère de Dieu après l’épiclèse.
Ménée (n.m.) : (du grec " livre du mois ") Livres liturgiques, souvent un pour chaque mois, contenant les parties variables des offices des fêtes fixes de l’année liturgique (pour le cycle pascal, voir Triode).
Ménologe (n.m.) : Recueil contenant les vies des saints classées par mois et jour d’après la date de la célébration de leur fête ; voir aussi Synaxaire.
Métanie (n.f.) : (du grec métanoïa " repentir, pénitence ") Inclination profonde du buste (petite métanie) ou prosternation jusqu’à terre (grande métanie), suivi d’un signe de croix. Une petite métanie est accompagnée d’un geste de la main droite qui touche la terre, en signe d’humilité. On ne fait pas la grande métanie pendant la liturgie du dimanche, mais on peut la faire à certains moments pendant les liturgies en semaine, ainsi qu’aux offices du Grand Carême.
Métanoïa (n.f.) : (grec " pénitence, conversion, repentir ". L’action de l’esprit qui se détourne du monde pour aller vers Dieu, dans une profonde attitude de reconnaissance de ses péchés et ses faiblesses et de la miséricorde divine.
Métropolite : (grec : metropolis " capitale ") Généralement, évêque de la capitale (ville principale ou métropole) d’une province ecclésiastique (métropolie), surtout dans l'Église orthodoxe russe. Aussi archevêque dans certaines Églises ou chef de quelques Églises autocéphales.
Microcosme : (du grec, " petit cosmos ") Condition centrale de l’homme dans la création, composé d’éléments matériels (minéral, végétale et animale) et spirituel (angélique), possédant des qualités divines ainsi que le désir de l’éternité. Voir aussi Image et Ressemblance.
Miséricorde : Qualité divine qui comprend à la fois tendresse, pardon, patience, compassion, fidélité, bonté, grâce, clémence. La " pitié " que nous demandons de Dieu est en fait une supplication de sa miséricorde infinie.
Molében (n.m.) : Office slave d’intercession pour un ou plusieurs vivants, bien portants ou malades.
Monarchie : (du grec, " un seul principe ") En théologie trinitaire, exprime la qualité du Père comme source unique et personnelle de la divinité, seule origine éternelle du Fils et de l’Esprit Saint. Voir aussi Génération et Procession.
Monogène (n.m.) : (du grec, " unique enfant ") Réfère au Logos, le Fils unique de Dieu Cf. le chant de la Divine Liturgie qui porte ce nom, attribué au patriarche Sévère d’Antioche et qui aurait été introduite dans la Liturgie byzantine par l’empereur Justinien.
Monophysisme (n.m.) : (du grec mono " un, seul " et physis " nature ") Hérésie reconnaissant une seule nature au Christ, la divine. Les Églises monophysites (coptes, arméniennes, éthiopiennes et syrienne-jacobites) sont celles qui n’ont pas accepté les décisions du concile œcuménique de Chalcédoine (451).
Monothélétisme (n.m.) : (du grec mono " un, seul " et theletis " volonté ") Hérésie qui n’accorde au Christ qu’une seule volonté.
Mont Athos : Haut-lieu de la spiritualité orthodoxe depuis le Xe siècle, où sont situés vingt monastères sur la péninsule de Akti, au nord de la Grèce, dominée par le Mont Athos (Agion oros en grec, la " Sainte Montagne "). Myron (n.m.) : Synonyme de Saint chrême.
Myrophores (n.m. ou f., aussi adj.) : Les femmes porteuses de parfum au tombeau du Christ (cf. Mc 16,1-2), commémorées le troisième dimanche de Pâques ; désigne aussi Nicodème et Joseph d’Arimathie, par exemple sur l’épitaphios.
Myrrhe (n.f.) : Résine odorante fournie par un arbre d'Arabie, aromate utilisé pour oindre le corps d'un mort. Les textes liturgiques voient dans le présent de la myrrhe offerte par les Mages au Messie à Bethléem un symbole de la passion du Seigneur et du don de l'immortalité aux hommes.
Mystagogique (adj.) : Du grec, " qui se rapportent aux mystères ", c’est-à-dire les sacrements ; enseignement sur les sacrements destiné avant tout auxnéophytes.
Mystère : Vérités de foi inaccessibles à la raison, en particulier la réalité divine révélée par les Écritures, à laquelle nous sommes appelés à participer par la grâce. Désigne aussi les principaux événements de l’Incarnation du Christ, sa mort et sa Résurrection, ainsi que les sacrements, notamment l’eucharistie.

