Lettre S - Rouen FR
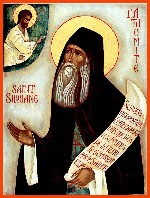

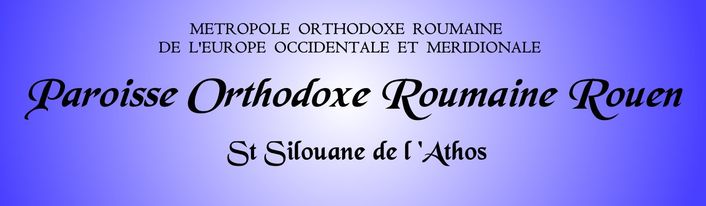
Lettre S
Lexique orthodoxe
Sabellianisme : Enseignement hérétique, une forme de modalisme, de Sabellius au IIIe siècle, selon lequel le Père, le Fils et l’Esprit Saint ne sont pas trois personnes divines distinctes, mais simplement des " modes " ou des " aspects " différents de la Divinité, manifestés à l’homme à différents moments selon les circonstances.
Sacerdoce : (du latin " se rapportant à la prêtrise ") Le Christ est le seul Grand Prêtre et tout exercice du ministère de prêtre se fait en rapport au sacerdoce du Christ. Les évêques, successeurs des apôtres, exercent la fonction sacerdotale dans une communauté déterminée ; les prêtres et les diacres sont leurs délégués. Tout fidèle a un rôle sacerdotale dans le sens de l’offrande de sa vie, de son entourage et de toute la création à Dieu.
Sacrement : (en grec mystêria) Acte rituel servant à la sanctification des fidèles, rendu efficace par l’action de l’Esprit Saint, chaque sacrement étant un mystère unique de l’Église, dans lequel Dieu partage la vie divine avec l’humanité. L’Église orthodoxe, de même que l’Église romaine mais avec des différences importantes quant à la forme et à l’usage, reconnaît sept principaux sacrements : le baptême, la chrismation, l’eucharistie ou la communion, la pénitence (confession et absolution), l’ordre (ordination à la prêtrise), le mariage et l’onction des malades. D’autres rites sacrés sont aussi considérés comme sacrements, notamment la profession monastique, les funérailles, la consécration d’une église, de l’autel et du saint chrême.
Sacramentaux : Signes sensibles institués par l’Église en vue d’obtenir des grâces de Dieu, par exemple l’eau bénite, l’encens etc.
Salut : (du latin, " sauf ") Ré-ouverture par le Christ, par son Incarnation, sa Mort et sa Résurrection, à l’homme la voie de l’union avec Dieu (Théosis ou Déification), rendue nécessaire suite à l’introduction dans la création du péché et de la mort, qui sont la séparation d’avec Dieu.
Sanctoral : Ensemble des chants et textes variables ou propre des fêtes des saints, se trouvant surtout dans les Ménées.
Sanctus : (latin " saint ") Chant juste avant la prière de l’oblation de la Liturgie, qui rappelle la louange incessante des anges : Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Hosanna dans les lieux très hauts. Béni est celui qui vient au Nom du Seigneur. (Cf. Is 6,1-3 et Ap 4,8).
Saint : La sainteté est un attribut fondamental de Dieu. L’homme, créé à l’image de Dieu, est appelé à la sainteté. Dans l’Église primitive, les saints étaient les baptisés qui vivaient dans l’esprit évangélique. De nos jours, les saints sont ceux reconnus par l’Église qui ont atteints, dans cette vie, à un degré important de participation à la sainteté de Dieu et qui intercèdent pour les vivants devant Dieu.
Saint des Saints : Autre nom pour le sanctuaire d’une église, à l’instar du Temple de Jérusalem.
Sainte Montagne : Voir Mont Athos.
Sainte Sophie : La Sagesse divine. L'Église de Sainte-Sophie de Constantinople était l'Église impériale de l'Empire byzantin, construite au VIe siècle par l'Empereur Justinien ; sous les Turcs, elle est devenue une mosquée, puis, avec l'état séculier des années 20, un musée.
Saints Dons : Le pain et le vin qui au cours de la Liturgie sont offerts à Dieu, changés par l’Esprit Saint en Corps et Sang du Christ et donnés en communion aux fidèles.
Sanctuaire : (du latin " lieu saint ") Partie de l’église où est situé l’autel, donc à l’intérieur de l’iconostase ; aussi tout l’édifice de l’église.
Schisme : (du grec " séparation ") Séparation d’une partie de l’Église, qui n’implique pas nécessairement une question de dogme ; " le grand Schisme " désigne la séparation entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, formellement en 1054.
Skoufa et Skoufos : Voir Calimavkhion.
Septante (n.f.) : (litt. " soixante-dix ") Traduction grecque de l’Ancien Testament, faite à Alexandrie au IIIe troisième siècle avant Jésus-Christ, qui est utilisée, retraduite dans d’autres langues, dans la plupart des Églises orthodoxes.
Sexte (n.f.) : La sixième heure, office célébré vers midi.
Signe de Croix : Geste commémoratif de la Croix de la Passion du Christ, ainsi que de la Sainte Trinité, fait de la main droite touchant successivement le front, l’abdomen, l’épaule droite et l’épaule gauche. Le mouvement du haut vers le bas peut signifier aussi " que la connaissance descend dans le cœur ", et de droite à gauche, " que la justice (droite) passe d’abord mais la miséricorde (gauche) a le dernier mot " ou encore " qu’au Jugement Dernier je sois à la droite du Christ et non à sa gauche ".
Skhima ou Schème (n.m.) : Habit monastique. Le grand schème est l'insigne de l'échelon monastique le plus élevé.
Skite (n.m.) : Habitation monastique ou groupement d’habitations occupées par un ou quelques moines.
Simandre (n.m.) : Planche de bois sur laquelle on frappe, habituellement avec un marteau de bois, dans un monastère pour annoncer les offices.
Slavon (n.m.) : Langue liturgique établie par saints Cyrille et Méthode au Xe siècle, utilisée par les Églises de Russie, Bulgarie et Serbie.
Sobornost (n.m.) : (russe, sobor, " réunion, collégialité ") Ensemble des croyants. Catholicité au sens premier et fondamental de ce terme.
Sobriété : Voir Vigilance.
Solea (n.f.) : (du latin " plancher, sol ") Partie surélevée de quelques marches devant l’iconostase d’une église.
Sotériologie (n.f.) : (du grec, sôteria, " salut ") Doctrine du salut, de rédemption.
Subordinatianisme : Enseignement, présent déjà chez Origène et plus particulièrement souvent chez les Gnostiques et les Manichéistes, qui perçoivent la Trinité comme une hiérarchie de personnes, le Fils et l’Esprit Saint étant subordonnés au Père et inférieurs à lui, . Surressentiel,
Super-essentiel : Traduction du grec hyperousios, " au-delà de l’essence ". Dans la théologie apophatique, en particulier chez le pseudo-Denys l’Aéropagite, indique que Dieu dépasse toute idée ou concept humains, même celui de l’être ou de l’essence, ce qui renvoie au Dieu vivant, plutôt qu’au Dieu des philosophes.
Stavrothéotokion (n.m.) : Tropaire ou stichère en l’honneur de la Croix et de la Mère de Dieu, qui remplace le théotokion habituel chaque fois que l’on célèbre la Croix.
Starets (n.m.) : (du russe, " vieillard " ; en grec, géron) Moine qui a passé sa vie dans l’ascèse, pouvant donner des conseils en tant que père spirituel. Féminin,Staritsa.
Sticharion (n.m.) : Aube liturgique ; une longue tunique portée sur la soutane.
Stichère (n.m.) : Originellement versets de psaumes, puis strophes intercalées entre les derniers versets des psaumes aux vêpres et aux matines.
Stichologie (n.f.) : Lecture continue du Psautier, à vêpres et à matines.
Suggestion : (grec prosbolè " lancer vers ") Atteinte à la vigilance, agression des pensées du mal. Voir Pensée, Consentement et Réfutation.
Surressentiel ou superessentiel (adj.) : (grec hyperousios) Ce qui est plus haut que l’être, ce qui renvoie au Dieu vivant.
Symbole : (du grec sumbolon " signe, marque ") Une réalité dans le monde visible qui correspond à une autre réalité au-delà de ce qui est représenté ; le symbole liturgique est un signe qui pointe vers la vérité originelle qui ne peut être atteinte sans lui. Le symbole n'est jamais déchiffré une fois pour toutes, mais est une réalité vivante qui nous transforme, qui unit le créé à l'incréé, le visible à l'invisible ; au contraire, le " dia-bole ", ou diable, est ce qui divise.
Symbole de foi : Aussi appelé Credo. Formulation ou profession de la foi chrétienne. Le Symbole de NicéeConstantinople, le plus utilisé dans l’Église orthodoxe et qui remonte aux Conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, est intégré à la célébration eucharistique.
Synaxaire (n.m.) : Livre annonçant la synaxe, ou fête du jour, et contenant un éloge, un résumé de la vie du saint ou un bref exposé sur la fête ; plus généralement, livre contenant les vies des saints.
Synaxe (n.f.) : (grec, " réunion ") Assemblée de croyants pour une prière commune ; plus spécifiquement, fête célébrée au lendemain d'une grande fête ; aussi, regroupement des saints ou d’anges, par exemple sur une icône.
Synergie (n.f.) : Coopération ou collaboration de la volonté humaine avec la grâce divine, avec l’Esprit Saint dans la voie vers Dieu ; cf. saint Paul : Nous sommes les coopérateurs de Dieu (1 Co 3,9)
Synode (Saint) (n.m.) : Réunion des évêques d'une Église orthodoxe sous la présidence de leur chef (patriarche, métropolite, archevêque), instance suprême de l'autorité ecclésiastique.

